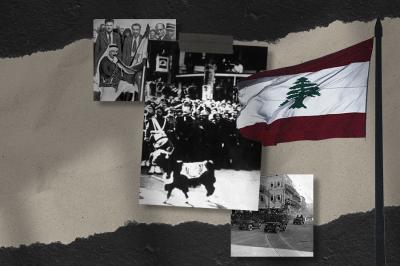Il y a à peine trois ans, les États-Unis réévaluaient encore leur relation avec le Royaume d’Arabie saoudite.
C’était sous le mandat du président démocrate Joe Biden.
Aujourd’hui, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane quitte le Bureau ovale après avoir rencontré le président républicain Donald Trump, ayant obtenu presque tout ce qu’il souhaitait — alors que Trump, lui, avait déjà obtenu l’essentiel avant même la rencontre, à la faveur de sa récente tournée dans le Golfe.
Tout cela intervient dans une nouvelle phase des relations bilatérales, où le président américain apporte une touche personnelle incontestable.
Ainsi, Ben Salmane passe d’une tentative d’isolement orchestrée par Biden à une position de partenaire militaire privilégié de Washington — à tel point que son hôte est allé jusqu’à rabrouer publiquement un journaliste de la Maison-Blanche pour une question sur l’assassinat du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi.
La scène reflète une volonté claire d’approfondir les liens avec Riyad, qui a promis près de mille milliards de dollars d’investissements dans l’économie américaine, tout en préservant des relations d’affaires avec la famille Trump elle-même.
Ce tournant intervient alors que Trump renonce à la condition qu’exigeait depuis longtemps Washington avant de conclure tout accord majeur de défense et de commerce avec Riyad : une normalisation complète avec Israël.
Biden insistait pour que tout accord global américano-saoudien avance selon trois volets inséparables : l’accord bilatéral de défense et de commerce, la normalisation saoudo-israélienne, et un engagement israélien clair à s’engager sur une voie menant à un État palestinien.
Mais le refus israélien d’un État palestinien et l’inflexibilité saoudienne ont fait s’effondrer ce cadre.
Le « grand prix » est venu lorsque les États-Unis ont désigné l’Arabie saoudite comme « allié majeur non membre de l’OTAN », ouvrant la voie à la vente d’avions de chasse F-35.
L’accord prévoit également la vente de 300 chars américains à Riyad et la simplification des opérations des entreprises américaines de défense dans le royaume.
Les deux parties se sont entendues sur un cadre de coopération en intelligence artificielle, incluant l’autorisation de vendre des puces avancées à l’Arabie saoudite ; elles ont aussi signé un accord sur les minerais critiques et ouvert la porte à une coopération élargie dans le nucléaire civil — sans pour autant accorder à Riyad le droit d’enrichir l’uranium.
Ainsi, l’Arabie saoudite obtient l’essentiel de ce qu’elle recherchait — sans toutefois atteindre le niveau de protection dont bénéficie le Qatar, qui entretient la relation sécuritaire la plus forte avec Washington, surtout après avoir été ciblé par Israël.
Le Qatar accueille la plus grande base aérienne américaine de la région, a été désigné allié majeur non-OTAN en 2022, et a reçu cette année la garantie de sécurité américaine la plus ferme jamais accordée à un pays arabe :
un décret stipulant que « les États-Unis considéreront toute attaque armée contre le territoire, la souveraineté ou les infrastructures critiques du Qatar comme une menace contre la paix et la sécurité des États-Unis ».
L’Arabie saoudite avait déjà étendu ses partenariats vers l’Est, notamment vers la Russie et la Chine, afin de diversifier ses liens de défense.
Riyad a progressivement renforcé ses relations avec Pékin, couronnées par la surprenante réconciliation saoudo-iranienne annoncée dans la capitale chinoise en mars 2023.
Cette année, le royaume a signé un pacte de défense avec le Pakistan, puissance nucléaire — un signal clair de sa volonté de diversifier ses partenariats sécuritaires.
Les États-Unis souhaitent désormais que l’Arabie saoudite devienne un partenaire stratégique clé dans leur compétition avec la Chine, voyant dans le royaume à la fois un immense marché pour la technologie américaine et un rempart contre l’expansion chinoise.
Et Israël dans tout cela ?
Naturellement, les accords de défense ont soulevé des questions concernant Israël.
La loi américaine exige que toute vente d’armes avancées au Moyen-Orient ne compromette pas l’avantage militaire qualitatif d’Israël.
L’État hébreu semblait informé de l’accord et ne s’y est pas opposé après avoir reçu l’assurance que son avantage qualitatif serait préservé.
Lorsque l’Arabie saoudite recevra ses premiers F-35, Israël bénéficiera déjà d’une avance de quinze ans et en aura acquis environ 75.
L’ouverture américano-saoudo-iranienne
La nouvelle nature du rôle saoudien se révèle dans sa médiation entre l’Iran et les États-Unis — dépassant Israël, qui envisage continuellement de frapper le régime de Téhéran.
Après sa rencontre avec Trump, Ben Salmane a reçu un message du président iranien Massoud Pezeshkian saluant le rôle de l’Arabie saoudite comme force d’équilibre au milieu des contradictions du Golfe et du Moyen-Orient.
Un fait notable : avant la rencontre Ben Salmane–Trump, les Iraniens avaient informé les Saoudiens de leur disponibilité à parvenir à un accord avec les Américains.
Un geste amical et de haut niveau signalant que Téhéran entame une phase de négociation cruciale pouvant déboucher sur un accord indirect avec Trump.
Les Saoudiens ont saisi l’occasion et ont répondu positivement.
Jouer ce rôle de médiateur actif pourrait permettre au royaume de façonner une stratégie de stabilité régionale.
La surprise est venue du ton étonnamment positif employé par Trump lors de son échange avec Ben Salmane.
L’Iran a besoin de stabilité interne et régionale, ainsi que de reconstruction — particulièrement économique — et a donc initié une ouverture que Riyad et Washington ont rapidement embrassée.
Il en résulte un cadre trilatéral public inédit ouvrant une fenêtre stratégique via l’Arabie saoudite — l’aînée du Golfe — et non par un autre État.
Mais les partisans du rapprochement en Iran craignent une résistance politique interne ou l’obstruction par les opposants aux négociations — ou par les critiques du futur rôle saoudien.
Influence régionale… et nouveaux équilibres
Aujourd’hui, l’Arabie saoudite se trouve face à une opportunité d’exercer une influence régionale allant du Golfe à la Méditerranée — en Syrie et au Liban pour assurer la stabilité et des compromis politiques internes, en Asie occidentale, en Afrique, et même en Palestine, mais avec un partenaire israélien autre que le Premier ministre Benjamin Netanyahou, afin de reconstruire Gaza avec un financement arabe et d’assurer un processus de paix garantissant les droits palestiniens.
Et si Washington cherche à maintenir Riyad dans sa sphère d’influence alors qu’elle redessine un nouveau Moyen-Orient post-Gaza sous les bannières de la paix et des « Accords d’Abraham », le prix américain sera de contenir Israël avant de le préparer à la paix avec le partenaire arabe le plus important.
Mais une question demeure : l’Arabie saoudite aura-t-elle suffisamment de temps, avant la fin du mandat de Trump, pour mettre en œuvre sa vision de la région ?
Prière de partager vos commentaires sur:
[email protected]
 Politique
Politique