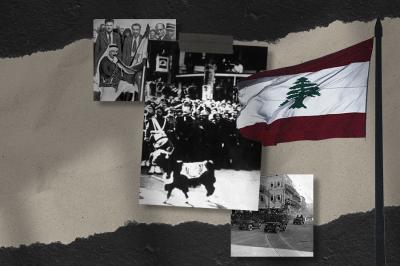Un effondrement financier catastrophique ! C’est ainsi que l’on peut décrire la crise que traverse le Liban depuis 2019.
Cette crise résulte de l’intersection entre un effondrement financier provoqué par des décennies de mauvaise gouvernance budgétaire et de profonds déséquilibres économiques structurels, ainsi que d’une instabilité géopolitique chronique dont le Liban a été l’un des principaux théâtres.
Cela a rendu le défaut de paiement de mars 2020 inévitable plutôt qu’accidentel.
Les fondements économiques théoriques de l’effondrement
L’analyse révèle que les évolutions économiques et financières du Liban — malgré leur caractère chaotique — ont suivi une trajectoire logique décrite par la science économique.
Ces évolutions peuvent être attribuées à trois maladies économiques interdépendantes.
Comprendre ces maladies constitue une base solide pour analyser la crise libanaise multiforme, qui n’était pas simplement un effondrement financier mais une crise structurelle profonde.
Premièrement — Le modèle de l’État rentier financier :
L’adoption de ce modèle a été l’erreur fondamentale du Liban, car l’élite politique au pouvoir l’a conçu pour attirer des flux de capitaux.
Selon la « théorie de l’État rentier », le cas libanais est un exemple parfait d’État rentier financier, où la rente provient de mécanismes financiers et d’afflux de liquidités extérieures plutôt que de ressources naturelles comme le pétrole.
Une analyse approfondie des flux financiers entrant au Liban révèle trois sources principales :
les transferts des expatriés, l’aide et les dépôts étrangers, et les « ingénieries financières » mises en œuvre par la Banque du Liban pour attirer des dépôts à taux d’intérêt élevés.
Par conséquent, les recettes de l’État ont été déconnectées des impôts prélevés sur l’activité économique locale, rendant le gouvernement dépendant des flux extérieurs plutôt que de la fiscalité — une opération de tromperie majeure qui a masqué l’insoutenabilité budgétaire.
Cela a permis à l’élite dirigeante d’utiliser les ressources publiques pour entretenir des réseaux clientélistes et la corruption au lieu d’investir dans le développement, créant au final une spirale de dette incontrôlable.
Ces flux ont provoqué une forme aiguë de « mal hollandais », créant un mélange de dépendance aux capitaux extérieurs, d’érosion du secteur productif et d’une dynamique insoutenable de la dette publique.
Deuxièmement — La théorie du mal hollandais :
Les énormes flux financiers générés par le modèle rentier (des dizaines de milliards de dollars par an) ont créé un phénomène semblable à une « manne pétrolière ».
Cela a directement relevé le taux de change réel de la livre libanaise, rendant les produits importés bon marché et les produits exportés coûteux, générant un déficit commercial chronique d’environ 15 milliards de dollars par an.
Inévitablement, les secteurs industriel et agricole se sont effondrés faute de compétitivité, tandis que le secteur des services a prospéré.
Cela a créé une économie fondée principalement sur des importations et une consommation excessives sans aucune capacité productive pour les financer.
L’arrêt brutal des flux financiers en 2019 a été l’étincelle qui a déclenché l’effondrement.
Troisièmement — La théorie de la dynamique insoutenable de la dette (r > g) :
Son principe fondamental est que le ratio dette/PIB augmente rapidement lorsque le taux d’intérêt réel moyen sur la dette (r) dépasse constamment le taux de croissance réelle du PIB (g).
Cela a rendu le contrôle de la dette publique presque impossible, faisant du défaut une simple question de temps.
Mécaniquement, le mal hollandais a freiné la croissance réelle, tandis que les flux financiers extérieurs ont imposé des taux d’intérêt élevés pour les attirer.
Le résultat comptable a été catastrophique : le taux d’intérêt réel moyen sur la dette a explosé par rapport à la croissance réelle du PIB, tandis que l’endettement continuait d’augmenter.
La dette publique a doublé entre 2006 et 2016, tandis que la croissance économique déclinait après 2011.
Le facteur géopolitique qui a amplifié la crise
Les tensions géopolitiques ont joué un rôle amplificateur majeur dans la crise libanaise depuis le milieu des années 1990.
Ces répercussions se sont intensifiées après la guerre de juillet 2006, en particulier le long de la frontière sud et à l’intérieur du pays durant les années suivant le début du conflit syrien en 2011.
Chaque fois que des signes de stabilité relative apparaissaient, des chocs géopolitiques frappaient l’économie et la ramenaient à zéro.
Premièrement — Les dégâts matériels directs du dernier conflit, qui ont provoqué d’énormes destructions des infrastructures et des habitations dans le Sud.
Selon les estimations de la Banque mondiale, les pertes économiques directes dues à ce conflit ont atteint environ 14 milliards de dollars.
Les seuls besoins de reconstruction dépassent quant à eux 11 milliards de dollars.
Deuxièmement — Les effets à long terme sur les secteurs vitaux, car des secteurs essentiels de l’économie libanaise ont subi de lourdes pertes.
Des secteurs comme le tourisme — principale source de devises — et l’agriculture ont été gravement touchés, avec d’énormes pertes de récoltes, une contamination des terres agricoles et des perturbations dans le commerce et la logistique au sud et dans la Békaa.
Troisièmement — Une contraction massive de l’économie, qui a rétréci depuis 2020 jusqu’à atteindre près de la moitié de son PIB d’avant la crise.
L’économie devrait encore se contracter cette année en raison des tensions géopolitiques persistantes.
Le cercle vicieux de la mauvaise gestion et des chocs géopolitiques
En conclusion, la crise libanaise peut être résumée comme un cercle vicieux alimenté par deux forces principales :
D’abord, une mauvaise gestion économique et financière chronique, exprimée à travers des modèles économiques présentant de profonds défauts structurels, a conduit à une explosion de la dette publique et à l’érosion des secteurs productifs.
Et l’enracinement d’une économie dépendante des flux extérieurs plutôt que de la production nationale et du développement.
Ensuite, des tensions et des conflits géopolitiques ont frappé l’économie à répétition et l’ont ramenée à zéro en raison des guerres internes et externes.
Par conséquent, toute voie de sortie de la crise doit être globale et simultanée, impliquant des réformes structurelles profondes pour démanteler l’économie rentière, construire une économie productive et résiliente, et engager une restructuration complète de la dette souveraine et du secteur bancaire.
Sans une telle approche intégrée, le Liban restera prisonnier de ce cycle destructeur.
Prière de partager vos commentaires sur:
[email protected]
 Politique
Politique