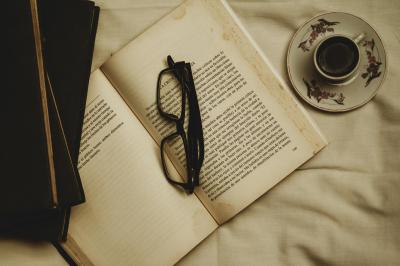La question du droit des femmes libanaises à transmettre leur nationalité à leurs enfants demeure l’un des débats les plus controversés en matière d’égalité au Liban. La loi, héritée depuis des décennies, réserve la transmission de la nationalité au père uniquement, laissant des milliers d’enfants dans une situation d’incertitude — apatrides ou en conflit d’identité — et obligeant des familles entières à lutter pour des droits fondamentaux tels que l’éducation, les soins de santé et l’accès à l’emploi formel.
La loi actuelle et ses implications pratiques
L’article 1 de la loi libanaise sur la nationalité (décret de 1925) stipule que « toute personne née d’un père libanais est considérée comme libanaise », excluant explicitement la mère comme source de nationalité. En pratique, un enfant né d’une mère libanaise et d’un père étranger n’acquiert pas automatiquement la nationalité libanaise — ce qui l’expose au risque d’être sans papiers, de vivre sous un statut restreint ou, dans certains cas, d’être apatride. Les organisations de défense des droits humains et les études locales ont documenté de nombreux cas de familles et d’enfants souffrant des conséquences de ce vide juridique.
La nouvelle campagne et l’initiative législative
À la mi-octobre 2025, la campagne « Ma nationalité est un droit pour moi et ma famille », en collaboration avec la députée Cynthia Zarazir, a annoncé le dépôt d’un projet de loi urgent visant à modifier l’article 1 afin qu’il soit formulé ainsi : « Est considéré comme libanais tout individu né d’un père ou d’une mère libanaise. » La proposition consiste simplement à ajouter le mot « mère » au texte actuel. La campagne a décrit cette initiative comme une étape concrète vers la fin d’une injustice historique et l’équité pour des milliers de familles.
Les partisans et les opposants — Les raisons de leurs positions
Les partisans
Les organisations de défense des droits humains et de la société civile affirment que l’amendement repose sur deux principes essentiels : l’égalité entre les sexes et le respect des normes internationales de prévention de l’apatridie. Un rapport du HCR a également souligné que les législations inégalitaires en matière de nationalité contribuent directement à la création de cas d’apatridie. Les partisans du changement estiment que la modification du texte protégerait les enfants et renforcerait la conformité du Liban à ses engagements internationaux relatifs aux droits des femmes et des enfants.
Les opposants
Des forces politiques et confessionnelles de divers horizons s’opposent à la réforme pour des raisons politiques et démographiques — principalement par crainte d’un déséquilibre du « système confessionnel » ou d’une modification des bases de la citoyenneté au sein de la population. Ces arguments dominent souvent le débat public et politique, bien qu’ils n’apportent aucune solution concrète à la situation des enfants apatrides ou aux souffrances quotidiennes des familles concernées. Certains acteurs politiques invoquent également des préoccupations liées à la sécurité nationale ou à la complexité administrative, mais ils proposent rarement des alternatives capables de protéger les droits.
Exemples régionaux et internationaux : où les mères ont le droit — et où elles ne l’ont pas
Certains pays arabes ont progressivement réformé leurs lois. Par exemple, l’Algérie et Djibouti accordent désormais aux femmes les mêmes droits que les hommes pour transmettre leur nationalité à leurs enfants. D’autres États arabes ont procédé à des révisions partielles ou autorisent des exceptions limitées, notamment lorsque l’enfant risquerait autrement de devenir apatride ou que le père est inconnu. Dans le monde, de nombreux pays ont amendé leurs lois sur la nationalité afin de lutter contre l’apatridie et la discrimination fondée sur le genre.
À l’inverse, le Liban reste parmi les pays — aux côtés du Koweït, du Qatar et d’autres États du Golfe — qui refusent encore, dans la majorité des cas, aux mères le droit de transmettre leur nationalité. Dans d’autres pays, des exceptions existent sous certaines conditions. Les rapports des Nations Unies et du HCR indiquent qu’environ 24 pays dans le monde maintiennent encore des lois discriminatoires en la matière.
Des cas réels qui illustrent l’ampleur du problème
Des rapports de terrain et des ONG ont relaté des histoires vécues : des enfants nés de mères libanaises dont le nom figure sur les actes de naissance, mais qui restent sans identité. D’autres se voient refuser l’accès à l’école publique, à un dossier médical ou à un emploi officiel plus tard.
Des organisations libanaises recensent des milliers de cas de femmes libanaises mariées à des étrangers et de leurs enfants vivant dans une insécurité juridique permanente. Ces situations mettent en lumière les conséquences matérielles, psychologiques et sociales de la loi actuelle.
Des experts juridiques et des défenseurs des droits humains — dont l’activiste Josephine Zgheib — ont déclaré à Al-Safa News que « la modification de l’article 1 complète les engagements internationaux du Liban en matière de droits de l’homme et de l’enfant, et constitue un moyen efficace de réduire l’apatridie ».
Zgheib a évoqué la position du HCR selon laquelle l’égalité entre les mères et les pères dans la transmission de la nationalité empêche directement la formation de groupes apatrides et allège la charge de protection qui pèse sur l’État et la société. Elle a ajouté que la crainte d’un « changement démographique » devrait être traitée à travers des politiques de données et de recensement, et non en privant les citoyens de leurs droits fondamentaux.
« En résumé, le point de vue juridique et des droits humains soutient largement la modification comme une solution pratique et nécessaire », a-t-elle conclu.
Mesures d’accompagnement et solutions pratiques proposées
La réforme devrait inclure des mécanismes procéduraux — tels que l’enregistrement des enfants concernés et la délivrance de documents civils temporaires pendant le traitement des demandes de nationalité. Un programme national devrait également documenter ces cas et traiter les questions de chômage et de droits sociaux des enfants touchés.
Des campagnes de sensibilisation pourraient aider à dissiper les craintes démographiques en précisant que la réforme vise à protéger les citoyens et leurs enfants, et non à modifier la structure démographique du Liban. Ces mesures garantiraient une mise en œuvre ordonnée de l’amendement tout en maintenant la confiance des parties prenantes.
Une question de principe
Le droit des femmes à transmettre leur nationalité est une question de principe — alliant justice, équité et respect des normes internationales visant à prévenir l’apatridie. L’amendement proposé par la campagne et la députée Zarazir s’inscrit dans un mouvement mondial en faveur de l’égalité entre les sexes et de la protection des enfants contre le vide juridique.
Répondre aux inquiétudes politiques nécessite un dialogue public fondé sur des données et des solutions concrètes — non le maintien d’un système qui prive des milliers de citoyens de leurs droits fondamentaux.
Recommandation finale : adopter l’amendement avec un plan d’application clair et un renforcement des registres civils afin de protéger les droits des enfants et des familles.
Prière de partager vos commentaires sur:
[email protected]
 Politique
Politique