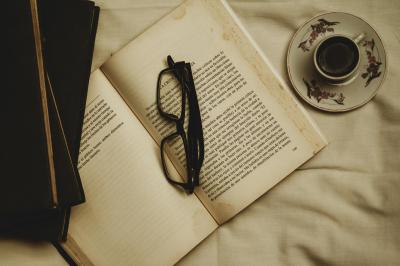Depuis ce mercredi après-midi, 133 cardinaux sont enfermés dans la chapelle Sixtine pour élire le prochain pape. Bien que certains noms de favoris circulent, l’issue du conclave demeure très incertaine, tant sur le plan du choix de l’homme que de l’orientation ecclésiale du futur pontificat.
Le premier vote, symbolique et prévisible, s’est soldé par une fumée noire au-dessus de la place Saint-Pierre. Ce tour initial sert traditionnellement à évaluer l’équilibre des forces en présence, loin des rumeurs ou du poids des spéculations médiatiques. À partir de maintenant, les cardinaux sont coupés du monde extérieur, sans aucune interférence médiatique ou politique possible.
Une élection marquée par des tensions et des divisions internes
Avant même l’ouverture du conclave, l’ambiance était tendue, alimentée par diverses polémiques et des attaques personnelles contre plusieurs prétendants. La messe votive du matin et la procession solennelle vers la chapelle Sixtine ont marqué le passage d’un climat conflictuel à un temps spirituel de discernement, avec le fameux « Extra omnes » signifiant le début du huis clos.
Malgré cela, l’enjeu reste profondément politique : il s’agit de désigner un pape capable de représenter une certaine ligne doctrinale face aux défis actuels de l’Église. À l’extérieur, environ 5 000 journalistes continuent à commenter, analyser et spéculer sur les chances des différents candidats.
Les favoris sous le feu des critiques
Le cardinal Pietro Parolin, ancien Secrétaire d’État et président du conclave, est le favori pressenti. On lui attribue un important socle de voix, bien qu’il soit sous le feu des critiques de tous bords: les progressistes l’accusent d’avoir passé des accords secrets avec les conservateurs (ce qui serait passible d’excommunication), dans le but de faire reculer certaines réformes du pape François, notamment sur la liturgie traditionnelle et la bénédiction des couples homosexuels. De l'autre côté, les conservateurs le tiennent responsable de l’accord controversé avec la Chine et des échecs du pontificat précédent.
D'autres noms circulent :
Cardinal Zuppi, proche de François, mais jugé trop lié à la communauté Sant’Egidio.
Cardinal Pizzaballa, jeune (60 ans) et donc potentiellement trop inexpérimenté.
Cardinal Arborelius, plus âgé (75 ans), séduirait ceux qui recherchent une solution transitoire.
Cardinal Aveline, qui tente de rassurer sur ses capacités linguistiques.
Cardinal Prevost, vu comme un compromis malgré des accusations de mauvaise gestion dans des affaires d’abus.
Cardinal Mario Grech, défenseur de la synodalité et possible garant de la continuité du pontificat François.
Cependant, aucun nom ne semble s’imposer clairement, à la différence de la dernière élection où l’intervention du cardinal Bergoglio avait orienté le vote de façon décisive.
Deux visions de l’avenir de l’Église s’opposent
Deux lectures s’affrontent au sujet de l’orientation que l’Église devrait prendre. La version officielle, relayée par le Vatican, suggère une volonté quasi unanime de continuer sur la voie tracée par le pape François. Mais une réalité parallèle, révélée par certains médias italiens et les confidences de cardinaux, suggère un net changement de ton.
Depuis la mort du pape François, des critiques plus ouvertes émergent : certains cardinaux remettent en cause son style de gouvernement jugé trop personnel, son mépris du droit canon, ou encore ses décisions « prophétiques » devenues, à leurs yeux, des ruptures avec la tradition. Des figures inattendues comme le cardinal Stella ont émis des reproches sévères, aux côtés de critiques plus attendues comme celles du cardinal Zen.
Des signes plus subtils indiquent aussi un retour à des formes liturgiques plus classiques, avec une plus grande attention à la beauté des célébrations, suggérant un rejet implicite de l’austérité liturgique prônée sous François.
Prière de partager vos commentaires sur:
[email protected]
 Politique
Politique