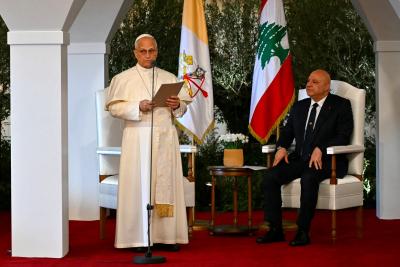Les fluctuations rapides et spectaculaires des prix de l’or ont révélé deux tendances marquantes dans le comportement des consommateurs libanais : la première est une soif impulsive d’opportunités d’investissement, la seconde est l’incapacité à trouver un terrain d’entente sur les grandes questions nationales. Si ce comportement peut nuire à l’économie, tant familiale que publique, il ouvre aussi un débat sérieux sur la nécessité urgente de mettre en œuvre des réformes destinées à orienter l’épargne vers les secteurs productifs, plutôt que de la figer dans des actifs spéculatifs.
Ces dernières semaines, de nombreux Libanais se sont précipités pour ressortir les dollars qu’ils « gardaient sous le matelas » afin d’acheter de l’or. La surprise ne résidait pas seulement dans le fait que l’or physique — qu’il s’agisse de pièces, d’onces ou de lingots — était introuvable chez les grands négociants, mais aussi dans les longues files d’attente observées dans les bijouteries, où certains acheteurs portaient des sommes impressionnantes en liquide. Une femme d’une quarantaine d’années, préférant garder l’anonymat, raconte en plaisantant : « Je suis allée, voilée, avec 4 000 dollars pour acheter une once d’or (pesant environ 31,1035 grammes), et j’ai été stupéfaite de voir d’autres sortir des centaines de milliers de dollars pour acheter de l’or au kilo. » Après une longue attente ponctuée de discussions sur la valeur de l’or et les prévisions géopolitiques et « trumpiennes », l’once a finalement été réservée pour livraison sous 80 jours, avec une commission supplémentaire de 100 dollars.
Ce que révèle la réaction des Libanais sur le plan économique
Cette anecdote singulière, bien que amusante, recèle de nombreuses implications économiques.
Premièrement, les Libanais détiennent encore d’importantes sommes en devises étrangères. Selon Abdel Hafiz Mansour, secrétaire général de la Commission d’enquête spéciale — l’unité libanaise de renseignement financier —, les ménages libanais détiendraient entre 5 et 6 milliards de dollars en espèces, comme il l’a déclaré lors d’une conférence de l’Union des banques arabes à l’été 2024. Le problème n’est pas seulement que cet argent se trouve hors du système bancaire, mais qu’il a perdu une grande partie de sa valeur à cause de l’inflation et de la dépréciation du dollar américain face aux autres monnaies. La majorité de ces fonds remonte à la fin de 2019 et au milieu de 2020, lorsque les déposants ont retiré ce qu’ils pouvaient de leurs comptes avant la conversion forcée en livres libanaises.
Deuxièmement, ces économies n’ont trouvé aucune véritable opportunité d’investissement interne depuis l’effondrement du secteur bancaire. Cela s’explique en grande partie par la faiblesse des marchés financiers et les tentatives répétées de démanteler, voire de supprimer, l’Autorité des marchés de capitaux. Si une réelle volonté de transformer ces épargnes en actions d’entreprises avait existé, elles auraient pu générer des rendements, renforcer les sociétés productives et de services, créer des emplois et relancer l’économie.
Troisièmement, les Libanais n’ont pas développé une culture de l’investissement dans les produits financiers ou les marchés internationaux. Pendant des années, les taux d’intérêt irréalistes offerts par les banques ont entretenu une forme de paresse financière, décourageant la recherche d’alternatives.
Quatrièmement, il existe un manque de réactivité face aux opportunités. Qu’il s’agisse d’or, d’argent, de cryptomonnaies ou d’autres actifs, beaucoup attendent trop longtemps avant d’agir. Les prix montent alors fortement, tout comme les commissions, réduisant les gains potentiels et augmentant le risque de perte.
Cinquièmement, une obsession généralisée du profit rapide prévaut, alors que l’investissement dans les métaux précieux — notamment l’or — ne le permet que rarement. Le métal jaune est avant tout une « réserve de valeur » à moyen et long terme, et non un moyen d’enrichissement immédiat. Les fluctuations à court terme nuisent souvent aux spéculateurs novices plutôt qu’elles ne les favorisent.
Sixièmement, la société libanaise reste absorbée par des débats stériles autour du sort des réserves d’or de la Banque du Liban, évaluées à environ 37 milliards de dollars, et de la question de leur conservation ou de leur utilisation. Ce débat, qui aurait pu être sain et constructif, est devenu un sujet de discorde politique.
Septièmement, on note une curiosité improductive, voire nuisible. Sur les marchés financiers, beaucoup suivent de près les prévisions sur le prix de l’or, sans avoir réellement la capacité d’investir. Ce comportement crée une pression artificielle sur les marchés et détourne le débat du cadre analytique rationnel, favorisant la propagation d’informations populistes et non fondées.
Huitièmement, la forte demande d’or importé — acheté sous forme d’onces ou de lingots pour être thésaurisé — aggrave le déficit commercial du Liban. Cette sortie de devises fragilise la capacité du pays à stabiliser le taux de change de la livre libanaise.
Un appel à la réforme financière
L’ensemble de ces comportements souligne l’urgence de réformes financières et bancaires capables de réintégrer ces épargnes dormantes dans le circuit économique, soit par les banques, afin de financer les secteurs productifs, soit par l’investissement direct dans les entreprises. De telles réformes profiteraient à tous, plutôt que de laisser ces actifs inactifs et improductifs.
Investir dans la réforme financière n’est plus une option, mais une nécessité économique, pour protéger l’épargne des Libanais et relancer l’économie nationale.
Prière de partager vos commentaires sur:
[email protected]
 Politique
Politique