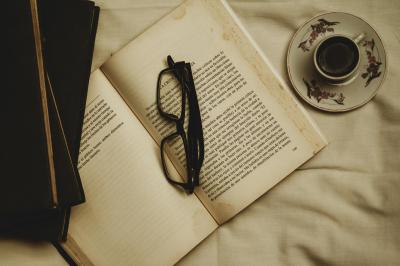Dans une nouvelle décision qui illustre les tensions croissantes entre les autorités libanaises et la population, le ministère de l’Intérieur a annoncé l’interdiction de l’usage des tuk-tuks comme moyen de transport public sur l’ensemble du territoire. Si le ministère justifie cette interdiction par des impératifs d’organisation et de sécurité publique, la mesure a suscité une vague de protestations populaires, notamment dans des régions comme la Békaa, Tripoli, Baalbek et Batroun, où le tuk-tuk est bien plus qu’un simple véhicule : il est devenu un véritable moyen de subsistance pour de nombreuses familles pauvres et marginalisées.
Le tuk-tuk : fruit de la crise, non du confort
Depuis des années, l’effondrement économique du Liban conditionne les choix quotidiens des citoyens. Avec la dépréciation massive de la livre libanaise et la flambée des prix du carburant, posséder une voiture ou emprunter les moyens de transport classiques n’est plus une option viable pour une grande partie de la population. Dans ce contexte, le tuk-tuk est apparu comme une solution pratique : économique, facile à conduire, particulièrement adapté aux zones sans infrastructures de transport public.
Pour de nombreux conducteurs, la décision gouvernementale fait abstraction du contexte social et économique qui a vu naître ce secteur informel. « Le tuk-tuk n’est pas un luxe, c’est un moyen de survie », explique l’un d’eux. Il permet à des dizaines de jeunes chômeurs de gagner un revenu, même modeste, et offre un moyen de transport abordable aux habitants des régions défavorisées.
D’une solution locale à un phénomène national
Ce qui n’était au départ qu’une réponse improvisée dans certains quartiers populaires est devenu un phénomène à l’échelle du pays. Cette expansion est due à plusieurs facteurs : l’absence totale d’alternatives, la tolérance implicite des municipalités et des forces de sécurité à ses débuts, ainsi que la capacité du tuk-tuk à circuler facilement dans les zones au relief difficile.
Mais les manifestations qui ont suivi l’annonce de l’interdiction montrent clairement que le tuk-tuk dépasse aujourd’hui le simple rôle de véhicule. Il est devenu le symbole d’une frange sociale marginalisée, prête à défendre son gagne-pain dans la rue. Un responsable sécuritaire a d’ailleurs confié au site Lebanon24 avoir été surpris par le nombre de manifestants, signe de l’ampleur du phénomène et de sa résistance à toute tentative de suppression.
Des problèmes réels… mais l’interdiction est-elle la solution ?
Il est vrai que l’utilisation des tuk-tuks soulève de vraies questions : la plupart ne sont pas immatriculés, ne passent aucun contrôle technique, et sont souvent conduits par des mineurs ou des personnes sans permis, mettant en danger les passagers comme les piétons. Pour autant, une interdiction généralisée semble être une réponse impulsive, dénuée de stratégie à long terme.
Comme l’explique le spécialiste des transports urbains, Dr Samer Badran :
« En l’absence d’une politique nationale de transport au Liban, interdire les tuk-tuks est une réaction émotionnelle qui ne traite pas le fond du problème. Il faut organiser le secteur, pas le supprimer. Il fait partie intégrante d’un tissu économique et social plus large. »
L’exemple international : des modèles à suivre
Dans de nombreux pays, le tuk-tuk a été intégré aux systèmes de transport public :
- Inde : il s’agit d’un moyen de transport populaire, réglementé, immatriculé, souvent subventionné pour passer à l’électrique.
- Égypte : malgré des défis, il est autorisé dans certaines zones rurales, avec une régulation progressive.
- Indonésie et Thaïlande : le tuk-tuk fait partie intégrante du paysage touristique et urbain, dans un cadre juridique clair.
Dans ces pays, les autorités ont cherché à intégrer plutôt qu’à interdire, en planifiant des réformes à long terme répondant aux besoins réels de la population.
Interdiction ou intégration : quelle voie choisir ?
Au lieu d’une interdiction brutale, les autorités libanaises auraient pu envisager des mesures progressives telles que :
- Délimiter des zones spécifiques où le tuk-tuk est autorisé sous conditions.
- Lancer des programmes d’immatriculation et d’assurance avec des incitations financières.
- Organiser des campagnes de sensibilisation et de formation en partenariat avec les municipalités.
- Imposer une taxe symbolique pour financer le transport public et réduire la charge sur l’État.
Conclusion : une vision progressive, pas une bombe sociale
La décision d’interdire les tuk-tuks reflète une fois de plus le fossé qui sépare les autorités libanaises de la réalité vécue par leurs citoyens. Dans un pays miné par des crises multiples, ce genre de mesure risque d’exacerber les tensions sociales et d’accentuer la précarité. Plutôt que d’imposer des décisions rigides qui frappent les plus démunis, l’État ferait mieux d’adopter une politique de transport inclusive, souple et équitable, qui reconnaisse les besoins actuels et les encadre intelligemment.
Car le problème, ce n’est pas le tuk-tuk en soi. Il est le reflet d’un désastre plus vaste. Et si ce désastre n’est pas abordé avec une approche sociale et économique globale, interdire ce véhicule ne freinera pas la colère… il l’accélérera — à l’image du tuk-tuk lui-même, qui slalome dans les ruelles des quartiers oubliés du Liban.
Prière de partager vos commentaires sur:
[email protected]
 Politique
Politique