Jacques Sapir,économiste et Directeur d'Etudes à l'EHESS (*1), détaille le rapprochement spectaculaire entre Trump et Poutine et ses conséquences économiques.
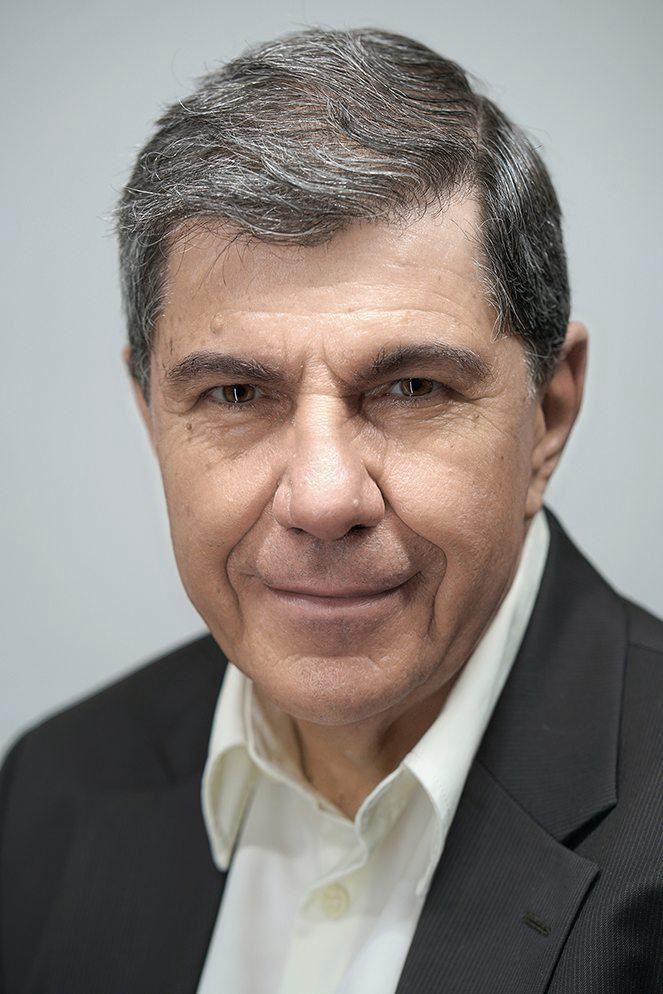
Après l’humiliation subie par Zelenski face à Trump dans le bureau ovale un accord de paix, un cessez-le-feu est-il possible rapidement comme l’avait annoncé le Président américain ?
Il convient de regarder la totalité des 40 minutes que durent la séquence. On voit clairement que Zelenski est, au départ, arrogant et relativement sûr de lui, et qu’il se refuse à l’idée de compromis. C’est ce qui fait dégénérer l’entretien, qui avait commencé de manière cordiale. Il est faux de parler de traquenard monté par Trump et Vance dans l’intention d’humilier Zelenski, comme on a pu l’entendre vendredi soir sur certaines chaines d’information en continu.
Mais, à la suite de l’incident, on peut deviner ce que sera la position américaine : soit Zelenski accepte rapidement les conditions d’un cessez-le-feu négocié entre Trump et Poutine soit l’aide américaine lui sera coupée. Or cette aide est considérable. Au-delà des armes et des munitions, c’est la fourniture à l’Ukraine de tout un soutien en matière de commandement, de renseignement satellitaire et électronique et en communications (Starlink). Si tout cela est retiré à l’Ukraine, ce ne sont pas les maigres moyens de l’UE-27 qui pourront le remplacer. La décrédibilisation de Zelenski comme partenaire d’un accord est importante aux yeux de l’administration Trump-Vance. On peut donc se demander si, pour aboutir à l’accord le moins défavorable possible à l’Ukraine, Zelenski ne serait pas bien inspiré de démissionner et de transmettre le pouvoir au Président du Parlement ukrainien.
Quelle stratégie veut mettre en place Donald Trump en agissant de la sorte ? L’accord sur les matières rares et minerais ukrainiens est-il caduc ?
Il faut comprendre que cet accord était essentiellement symbolique, car une partie des minerais dont il est question se trouvent déjà sous le contrôle de l’armée russe. Ce que Trump cherchait c’était de se faire (un peu) d’argent pour pouvoir dire au peuple américain « voyez comme je sais y faire, c’est différent de Biden », et surtout d’humilier Zelenski en lui faisant bien comprendre qui était le « patron ». Mais, cet accord était aussi un moyen détourné de donner une forme de garantie à l’Ukraine, car il impliquait une forte présence des entreprises américaines en Ukraine. C’est pour cela que Zelenski aurait dû ravaler sa légitime colère et le signer.
Désormais, tout devient très incertain. Il n’est pas dit que Trump ne se dise pas qu’il aura un accès à ces minerais, mais par les Russes, quand ils occuperont tout l’Est de l’Ukraine. Rappelons sa proposition d’un accord Américano-Russe sur un accès aux « terres rares ».
Vladimir Poutine semble avoir les mains libres en Ukraine. L’Europe se retrouve seule et en première ligne face à la Russie ?
Effectivement, la Russie semble avoir, si ce n’est les « mains libres » en Ukraine, à tout le moins de grandes possibilités sur l’Est de l’Ukraine. Tout dépendra en fait de comment le Président ukrainien réagira. Comprendra-t-il qu’il a perdu, et qu’il doit en tirer les conséquences, ou s’entêtera-t-il, et perdra de fait encore plus…
Mais, effectivement, une des conséquences de la scène assez incroyable dont nous avons été spectateurs le vendredi 1er mars est de précipiter la mort de l’OTAN. La confiance semble désormais rompue entre les dirigeants européens et les américains. Même si une autre administration venait au pouvoir à Washington, et ce pourrait n’être que dans douze ans car un des enseignements de cette scène a été l’intronisation de J.D. Vance comme successeur de Trump, le doute restera dans les têtes des dirigeants européens. Vouloir remplacer l’OTAN par une structure émanant de l’UE-27 est futile et dérisoire. Futile, parce qu’il y a trop de divergences au sein de l’UE-27 pour que l’on définisse des politiques opérationnelles commune.
Un axe fort s’est dessiné entre Trump et Poutine pour la « paix » en Ukraine. Quelle est votre analyse de cette nouvelle donne diplomatique ? Quelles implications économiques sous le regard inquiet de Pékin ?
Pour Donald Trump, il s’agit de liquider le problème ukrainien, qui est en réalité loin sur sa liste de priorités, pour se concentrer sur des sujets plus importants comme les relations avec la Chine, le Moyen-Orient, et la défense de l’économie américaine. Pour Vladimir Poutine, il s’agit de revenir, mais cette fois avec des garanties tangibles, à l’accord passé avec Gorbatchev en 1991, soit une remise en cause de l’extension vers l’Est de l’OTAN. Il faut prendre au sérieux ses objectifs qui ont toujours été vis-à-vis de l’Ukraine, neutralisation, démilitarisation et dénazification. La « Lune de Miel » entre Trump et Poutine durera jusqu’à ce que ces objectifs soient atteints pour Trump, et sans doute pour Poutine. Au-delà, Poutine reste persuadé que les intérêts des États-Unis sont contradictoires avec ceux de la Russie et il ne lâchera pas l’alliance pour l’ombre d’une amélioration des relations avec les USA, même s’il prendra tout ce qui est bon à prendre. Un point symbolique fort serait la reprise de bonnes relations économiques entre les deux pays, et donc l’abandon par les États-Unis des sanctions prises en 2022. Mais, ne nous y trompons pas, pour Poutine ce n’est qu’un point symbolique, car le commerce avec les USA ne représentait que 4% du commerce russe en 2021.
L’Europe s’est-elle ridiculisée ou a-t-elle pris un risque pour sa propre sécurité à venir en soutenant l’Ukraine face à la Russie ?
La réponse est les deux : l’UE s’est ridiculisée ET a pris un risque important pour sa sécurité. Elle s’est ridiculisée, car tout le monde peut constater que l’UE est bien plus en difficulté avec les sanctions qu’elle a prises que la Russie. Le prix du gaz a augmenté de 45% pour l’ensemble de l’UE-27 entre le deuxième semestre de 2021 et le premier semestre de 2024 selon Eurostat.Mais, pour certains pays, comme l’Allemagne, c’est pire puisque l’on atteint une hausse de 87%. Et tout cela pour passer de « l’Ukraine va récupérer ses territoires » à « la Paix, c’est pas si mal»…
L’UE a aussi pris un risque. En antagonisant la Russie, en envoyant du matériel militaire, en vidant nos réserves stratégiques, nous avons voulu montrer notre «détermination». Sauf que le matériel a été détruit, que nos arsenaux sont vides et nos armées dans un état aujourd’hui plus mauvais, par manque de matériel, qu’elles ne l’étaient en février 2022. C’est très bien de vouloir montrer ses muscles, encore faut-il en avoir !
L’Europe de la défense peut-elle suppléer à la disparition amorcée de l’OTAN ? Même si Trump a réaffirmé son soutien à l’article 5 (*2) du traité transatlantique…Ursula Von der Leyen annonce 800 milliards pour « réarmer l’Europe »…
Pour parler d’une Europe de la Défense, encore faudrait-il que les pays de l’UE-27 aient des intérêts communs. Ce n’est pas le cas. Certains pays européens peuvent avoir des stratégies communes : stratégie d’intégration avec la défense américaine(et donc stratégie de vassalisation complète) pour la Pologne et les pays du Nord de l’Europe, possible stratégie d’indépendance pour la France, l’Allemagne, les Pays bas et – peut-être – l’Italie et l’Espagne. Mais, avoir une stratégie commune se mesure à des actes et non à des déclarations, aussi tonitruantes soient-elles. Quand l’Allemagne passera une commande massive d’armements français on pourra y croire.
Le problème, ici, est que nos dirigeants – et je pense essentiellement aux dirigeants français – pensent que les mots sont des actes et des réalités. Ce faisant, ils commettent une erreur tragique. Sur la base de ce qui nous reste d’appareil militaire, essentiellement la dissuasion nucléaire, nous devons mettre nos partenaires au pied du mur et leur demander de choisir.
(*1) Ecole des hautes études en sciences sociales.
(*2) L'article 5 du traité de l'Atlantique Nord est la pierre angulaire de l’Otan. Cet article oblige chacun de ses membres à intervenir en cas d’agression contre l'un d'entre eux. Il n'a été utilisé qu'une seule fois dans l'histoire de l’organisation : au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis.
Propos recueillis par ERE
Prière de partager vos commentaires sur:
[email protected]
 Politique
Politique













