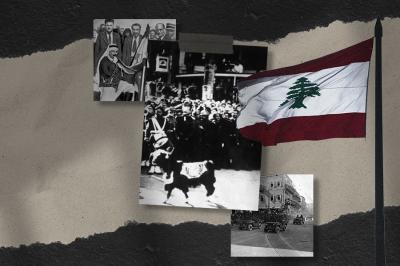Héritage historique: la langue française, une empreinte coloniale devenue culturelle
L’Afrique est aujourd’hui l’un des plus grands bastions de la langue française dans le monde. Sur les 321 millions de francophones dans le monde (chiffre OIF 2022), plus de 60 % vivent en Afrique. Cette présence résulte en grande partie de l’histoire coloniale : de vastes territoires du continent ont été colonisés par la France et la Belgique, imposant le français comme langue administrative, scolaire et judiciaire.
Mais au-delà de la colonisation, la langue française a été adoptée par de nombreuses élites africaines comme un outil d’émancipation, d’unité régionale et d’expression culturelle.
Léopold Sédar Senghor: un bâtisseur de la Francophonie africaine
L’un des pères fondateurs de la Francophonie moderne est Léopold Sédar Senghor, poète, penseur et premier président du Sénégal indépendant. Visionnaire, il voyait la langue française non comme un héritage à rejeter, mais comme un pont entre les cultures.
Pour Senghor, le français devait être un outil d’universalité, de dialogue entre l’Afrique et le reste du monde. Il cofonde, en 1970, avec Habib Bourguiba (Tunisie), Hamani Diori (Niger) et le prince Norodom Sihanouk (Cambodge), l’Agence de coopération culturelle et technique, qui deviendra plus tard l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
Senghor affirmait:
« La Francophonie, c’est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la Terre. »
Sous son impulsion, la Francophonie devient plus qu’un outil linguistique : un projet culturel et politique pour les pays du Sud.
Une langue sous tension: le français face aux crises politiques et sociales
Aujourd’hui, malgré sa forte implantation, le français est parfois perçu comme la langue du passé, voire de l’ingérence. Dans plusieurs pays africains, notamment au Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger), des tensions avec la France ont ravivé un sentiment anti-français. Le départ des troupes françaises, la montée des régimes militaires, et l’arrivée de nouveaux partenaires (Russie, Chine, Turquie) ont créé un climat de méfiance vis-à-vis de l’ancienne puissance coloniale.
Cette situation se traduit par:
La remise en cause de l’enseignement du français dans certaines écoles.
La promotion des langues locales (bambara, mooré, haoussa…).
Un tournant géopolitique vers des pays non francophones.
Pour autant, le rejet de la France n’est pas toujours synonyme de rejet du français. Beaucoup de jeunes continuent à voir dans cette langue un outil d’accès à l’emploi, à la culture, aux études à l’étranger.
Face à l’anglophonie: un avenir incertain ?
Un autre défi majeur pour la Francophonie africaine est la montée en puissance de l’anglais, notamment dans les domaines du numérique, des affaires, de la diplomatie et de l’éducation.
Des pays comme le Rwanda ont déjà basculé du français à l’anglais dans leur système éducatif. Même en Afrique francophone, de plus en plus d’écoles privées et universités proposent des formations en anglais, car cette langue est perçue comme plus « internationale » et « moderne ».
Et demain ? Réinventer la Francophonie en Afrique
Malgré ces défis, l’avenir de la Francophonie en Afrique n’est pas condamné. Au contraire, l’Afrique est la clé de sa survie. La démographie joue en sa faveur : d’ici 2050, près de 85 % des francophones dans le monde seront africains.
Pour que la langue française reste pertinente, plusieurs pistes sont proposées :
Valoriser le multilinguisme, en mettant le français au service des langues africaines.
Moderniser l’image du français, en l'associant à l'innovation, aux nouvelles technologies, aux arts urbains.
Renforcer la Francophonie économique, en favorisant les échanges entre pays francophones.
Dépolitiser la langue, en dissociant le français de la France et en mettant en avant une Francophonie plurielle et décentrée.
Le français en Afrique, entre héritage et choix
La Francophonie en Afrique est à la croisée des chemins. Héritage d’un passé complexe, elle ne pourra survivre que si elle devient un projet africain, porté par les jeunes générations, libéré des fantômes coloniaux, et capable de cohabiter avec l’anglais et les langues africaines.
Comme l’aurait dit Senghor: « Il ne s’agit pas de rejeter, mais de créer, ensemble. »
Prière de partager vos commentaires sur:
[email protected]
 Politique
Politique