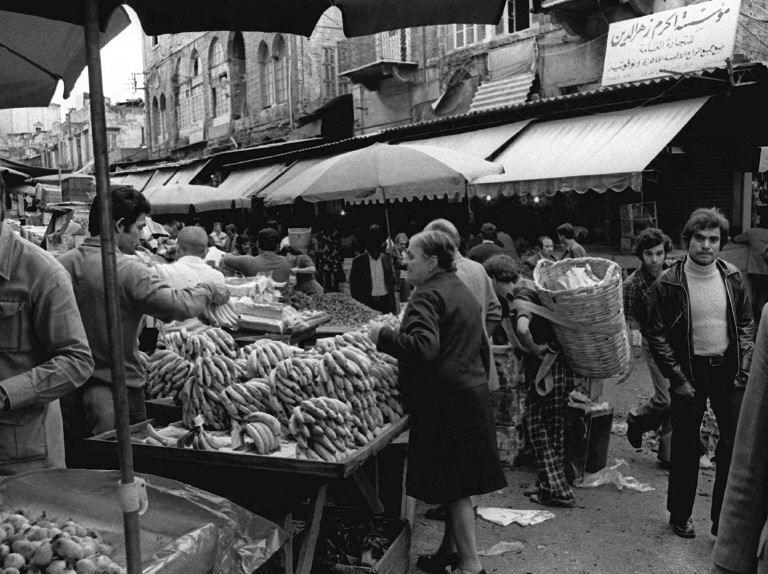Dans cette quatrième section du deuxième chapitre de l’ouvrage du Dr Nemer Freiha, Le programme d’histoire et ses manuels : un témoignage pour l’Histoire, l’ancien président du Centre pédagogique de recherche et de développement raconte les conséquences de la controverse autour du manuel d’histoire de la troisième année fondamentale.
Le ministre m’a convoqué, ainsi que les membres de la commission, à son bureau le 8 octobre 2001 pour discuter du manuel qui avait suscité la polémique. À notre surprise, il a également invité des représentants des syndicats d’enseignants, alors que nous pensions, en tant que membres de la commission, que la réunion était réservée aux personnes directement impliquées dans la rédaction ou la révision du manuel. Les participants ont alors entendu des remarques moqueuses concernant certains faits historiques contenus dans l’ouvrage—provenant de personnes qui n’étaient pas spécialistes en histoire. J’ai protesté vivement, et un procès-verbal de la réunion fut rédigé.
Le ministre était irrité par plusieurs passages du livre : la nationalité française de l’épouse de Taha Hussein ; l’acceptation par Abdelkader el-Jazairi d’une décoration française pour avoir protégé les chrétiens de Damas en 1860 ; ou encore l’enrôlement forcé de Hassan Kamel el-Sabbah dans l’armée ottomane. Ce sont pourtant des faits historiques incontestables qu’on ne peut falsifier pour complaire à tel ou tel. Le manuel présentait également des biographies de penseurs et de personnalités ayant consacré leur vie au service du Liban ou de l’humanité, destinées à servir d’exemples aux élèves. Que voulait donc que les auteurs écrivent ?
Un membre de la commission lui demanda ce qu’il souhaitait faire de la leçon. Il répondit qu’il voulait supprimer la narration chronologique mentionnant la « conquête arabe ». Nous avons alors proposé de supprimer toute la leçon et de la réécrire l’année suivante de manière à éviter toute interprétation ambiguë. Le ministre se tourna alors vers moi et exigea de voir les manuels de quatrième, cinquième et sixième années, qui étaient en cours d’impression.
Je lui expliquai que les manuels de quatrième et de sixième étaient effectivement à l’impression, tandis que celui de cinquième était encore à l’étude auprès du comité consultatif. Les deux premiers étaient déjà à l’étape des épreuves finales, et je proposai de les récupérer de l’imprimerie dès le lendemain pour les lui transmettre. Il me promit de les rendre sous 48 heures, ajoutant que, s’il avait des remarques, il les renverrait avec ces exemplaires. Le lendemain matin, les manuels furent livrés à son bureau. Mais les jours passèrent, puis les semaines, puis les années. Treize ans plus tard, ces deux manuels se trouvent toujours entre ses mains.
Par la suite, le ministre apparut à la télévision et accusa le Centre de produire des livres « pleins d’erreurs », répétant des accusations sans fondement soufflées par un groupe de colporteurs de ragots—issus du ministère comme du Centre—connus de tous pour leurs intrigues. Voir des responsables de l’éducation, censés former les générations futures, sombrer dans de tels comportements m’a profondément choqué. J’ai alors dû répondre par voie de presse, non pour m’abaisser à des querelles médiatiques, mais pour défendre l’institution et sa mission, qui dépassait ce genre de polémique. À cette époque, le Centre était une véritable ruche de travail, gérant de nombreux projets et publiant les manuels de troisième, sixième et neuvième années de l’enseignement fondamental, ainsi que de la troisième année secondaire dans ses quatre filières.
Avant la « crise de l’histoire », plus de 200 professeurs d’université, enseignants du secondaire et experts pédagogiques avaient travaillé sans relâche pour que tous les manuels soient prêts à temps pour la rentrée. Pendant ce temps, le ministre et son entourage s’employaient à mettre des bâtons dans les roues, dans le seul but de retarder la parution des livres et de s’affirmer comme l’autorité suprême en matière d’éducation. Or, l’éducation n’est pas un terrain pour des démonstrations de force : c’est un espace destiné aux apports intellectuels et aux réussites académiques qui servent les élèves, non les ambitions personnelles.
La défense du Centre contre cette campagne de dénigrement n’a pas suffi à convaincre l’opinion, car il ne s’agissait pas de défendre une personne mais une institution. Au contraire, plusieurs députés et anciens députés s’en sont pris au Centre et à son président. L’un d’eux voulut même « redorer son blason » en réclamant mon procès. Je l’aurais presque souhaité, afin de dévoiler les excès et l’hypocrisie de ceux qui s’étaient mêlés de cette affaire. Mais sa requête fut rejetée.
Dans les couloirs du ministère, on murmurait que le ministre voulait me révoquer, surtout après que le président de la République et le Premier ministre s’étaient entendus pour pourvoir les postes vacants en laissant aux ministres la liberté de choisir leurs directeurs généraux—comme si l’administration publique n’était qu’un salon où l’on installe des amis, entourés d’une cour espérant des bénéfices personnels.
J’envisageai alors de m’adresser directement au président de la République. Je m’en sentais d’autant plus encouragé qu’au cours d’une précédente rencontre au palais présidentiel, je lui avais exposé les pressions injustifiées que je subissais pour m’être obstiné à appliquer la loi et à exercer les prérogatives qu’elle m’accordait, tandis que le ministre voulait intervenir dans des domaines qui ne relevaient pas de lui. Je lui avais ajouté que mes collègues bénéficiaient tous de soutiens politiques les protégeant des pressions, alors que je n’étais aligné sur aucune faction, par choix. Le président me rassura : « Je suis votre référence, n’ayez crainte des abus de quiconque. » À la fin de notre entretien, très cordial, il me remit une carte portant son nom et plusieurs numéros de téléphone, dont trois étaient surlignés en jaune. « Gardez cette carte, me dit-il, et si quelqu’un franchit les limites de la loi avec vous, appelez-moi personnellement. »
En pleine bataille autour du manuel d’histoire, je ne pensais plus avoir d’autre recours que le président lui-même. C’est ce qu’il m’avait dit, et c’est ce que je croyais. J’avais tenté de rencontrer plusieurs responsables politiques pour leur expliquer la réalité du dossier et proposer une solution aux prétendues « erreurs » signalées par le ministre. Mais, à ma grande surprise, trois sur quatre annulèrent nos rendez-vous par l’intermédiaire de leurs bureaux. Craignaient-ils le ministre de l’Éducation s’ils me recevaient ? Étais-je devenu une sorte de « virus national » pour avoir supervisé un manuel qui expliquait aux élèves de troisième année l’indépendance du Liban—alors même que les dirigeants semblaient gênés d’évoquer cette indépendance et ce qu’elle représentait ? Craignaient-ils plutôt la réaction des Syriens ?
J’ai donc décidé d’exposer toute l’affaire, de A à Z, au président de la République, d’autant qu’il m’avait lui-même invité à le contacter en cas de besoin. J’ai appelé l’un des numéros figurant sur la carte qu’il m’avait donnée. Un de ses collaborateurs m’a répondu. Je me suis présenté, expliquant que le président m’avait demandé de l’appeler au besoin, et j’ai souhaité obtenir un rendez-vous urgent pour lui remettre les manuels d’histoire et clarifier les questions soulevées par le ministre. L’homme me promit d’en informer le président et de me rappeler. Les jours passèrent sans nouvelle. J’ai rappelé à plusieurs reprises depuis mon téléphone personnel, sans réponse. Le message était clair : même le président refusait désormais d’entendre ma version des faits, lui qui m’avait assuré être ma référence.
Le président craignait-il lui aussi le ministre ? Je n’en dirai pas plus.
Prière de partager vos commentaires sur:
[email protected]
 Politique
Politique