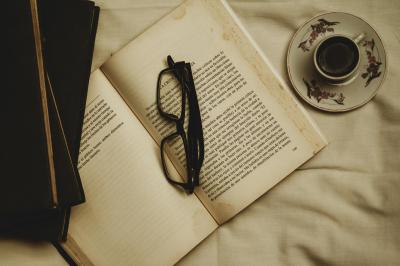Alors que les pourparlers médiatisés par Washington se poursuivent entre le Liban et Israël, une proposition controversée a surgi : la création de ce que l’on présente comme la « Zone économique Trump » sur certaines parties de la frontière sud du Liban. Bien qu’elle soit promue sous couvert de développement, les éléments disponibles indiquent que ce projet relève moins d’une initiative économique que d’une zone tampon sécuritaire — démilitarisée, dépeuplée et profondément ancrée dans les dynamiques régionales.
Une façade économique pour des objectifs sécuritaires
Le plan a été annoncé par l’émissaire américain Tom Barrack et soutenu par une délégation de sénateurs américains, dont Lindsey Graham. Son objectif affiché : stabiliser le Sud-Liban grâce à des investissements du Golfe, en particulier du Qatar et de l’Arabie saoudite. Mais derrière le discours se cache une finalité stratégique claire : empêcher le « Hezbollah » de rétablir sa présence dans la zone frontalière. Dans le cadre du cessez-le-feu de novembre 2024, le mouvement avait accepté de retirer ses forces, tandis qu’Israël continuait de violer la trêve et de détruire les infrastructures civiles et militaires au sud.
Bien que le projet mette en avant des initiatives industrielles et des créations d’emplois pour les habitants, sa première phase exigerait l’évacuation de vastes zones au nom de la sécurité. Les craintes libanaises portent ainsi sur un transfert démographique déguisé, où les populations locales seraient remplacées par une activité économique administrée de l’extérieur.
Investissement contre souveraineté
Sur le plan juridique, la Constitution libanaise interdit la cession de territoires, mais pas la création de zones économiques. Toutefois, des juristes avertissent que le projet risque de contrevenir à certaines dispositions du Code pénal qui sanctionnent l’octroi de privilèges spéciaux sur le territoire national à des entités étrangères ou non étatiques. Avec des zones toujours occupées par Israël, tout investissement resterait soumis à l’agenda sécuritaire de Tel-Aviv.
L’inquiétude majeure, selon ces sources, est que la zone proposée consolide un déplacement forcé, d’autant plus que l’exode se poursuit depuis octobre 2023, sans plan clair de retour des déplacés ni de reconstruction des villages détruits.
Entre optimisme prudent et réalités complexes
Certains considèrent le projet comme une opportunité de reconstruire et de relancer l’économie du Sud, à condition qu’il soit placé sous une supervision libanaise et internationale équilibrée, hors de toute mainmise israélienne directe. Des fuites médiatiques évoquent la création de sites industriels publics et des investissements du Golfe susceptibles de stimuler l’économie locale. Mais cet optimisme se heurte à plusieurs obstacles : le refus catégorique du « Hezbollah » de se désarmer sans garanties, la poursuite des agressions israéliennes et l’absence d’une stratégie économique nationale intégrée.
Leçons d’échecs historiques
Des précédents internationaux suscitent des doutes sur la viabilité du projet. La zone industrielle de Kaesong, lancée en 2002 entre les deux Corées, a fermé en 2016 en raison des tensions politiques. La zone industrielle d’Erez à Gaza, présentée comme un corridor de développement, a échoué après la seconde Intifada et s’est transformée en zone militaire fermée. Même la zone économique conjointe proposée entre les deux Chypres n’a jamais vu le jour malgré des financements européens. Ces exemples démontrent qu’une logique sécuritaire l’emporte souvent sur l’ambition économique, rendant ces projets fragiles et non durables, parfois convertis en outils de contrôle et de déplacement.
Le Sud-Liban sans atouts structurels
Pour réussir, une zone économique spéciale doit reposer sur certains fondements : proximité de ports actifs ou d’aéroports, réseaux de transport et d’énergie solides, et liens avec des centres de recherche et d’innovation. Le Sud-Liban, marqué par les conflits et dépourvu d’infrastructures adéquates, ne répond à aucun de ces critères. De plus, le Liban n’a ni relations commerciales ni accords de normalisation avec Israël, ce qui invalide l’idée d’une zone d’exportation ou de coopération commune.
Un projet suspendu entre sécurité et souveraineté
À ce jour, Washington n’a présenté aucune feuille de route claire pour la « Zone économique Trump ». Les détails cruciaux restent flous : limites de la souveraineté libanaise, identité des investisseurs et des opérateurs, garanties de retour des déplacés. L’initiative demeure donc une idée vague, oscillant entre deux scénarios opposés : soit une occasion rare de revitaliser le Sud et de ramener ses habitants, soit un instrument déguisé de déplacement à long terme sous le couvert de l’investissement.
Pour l’instant, les questions essentielles restent entières : l’avenir du Sud-Liban sera-t-il marqué par une croissance productive, ou sera-t-il réduit à une nouvelle zone tampon ? Cette zone deviendra-t-elle un levier de développement, ou un outil d’isolement répondant aux priorités sécuritaires d’Israël ? La réponse dépendra des décisions libanaises à venir, des garanties internationales et de la capacité à dépasser la logique des rapports de force.
Prière de partager vos commentaires sur:
[email protected]
 Politique
Politique