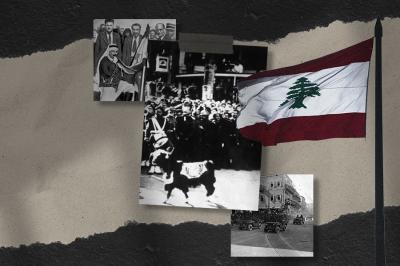Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les vainqueurs du conflit se réunissent à Potsdam, en Allemagne, afin de sceller les bases de la paix en Europe et de dessiner le nouvel ordre mondial. Pourtant, cette conférence, censée être un moment de consensus, marque en réalité le début d’une longue confrontation entre les puissances occidentales et l’Union soviétique : la guerre froide.
Un cadre chargé de symboles
La conférence s’ouvre le 17 juillet 1945 dans le palais Cecilienhof, ancienne résidence du prince héritier de Prusse, situé dans la zone d’occupation soviétique. L’endroit, bien que pittoresque, est cerné de ruines et infesté de moustiques. Il devient, pour deux semaines, le théâtre d’intenses négociations entre les trois grandes puissances victorieuses du nazisme : le Royaume-Uni, les États-Unis et l’URSS.
Winston Churchill est à l’origine de cette initiative. Dès le 6 mai, avant même la reddition de l’Allemagne, il propose une rencontre à Harry Truman, nouveau président américain, afin de définir l’après-guerre. Charles de Gaulle, pourtant chef de l’un des pays libérateurs, est exclu des pourparlers, ce qu’il dénoncera vivement.
Un climat de méfiance croissante
Churchill est préoccupé par les avancées soviétiques en Europe de l’Est. Il accuse Staline d’imposer des régimes communistes là où l’Armée rouge est passée. Il s'inquiète également du manque d’expérience de Truman, perçu comme trop idéaliste. Dans une lettre, il écrit : « Un rideau de fer s’est abattu sur le front soviétique. »
Truman, de son côté, n’arrive en Allemagne que le 15 juillet. Il rencontre Staline le 17, le qualifiant d’« extrêmement poli » mais manipulateur. La cordialité de façade masque mal les divergences profondes. La conférence débute ce jour-là, sous la présidence de Truman, à la suggestion de Staline.
Des négociations ardues
Parmi les principaux enjeux : le sort de l’Allemagne vaincue, la reconstruction de l’Europe, l’entrée en guerre de l’URSS contre le Japon, et la question des réparations. Le consensus initial sur l’Allemagne — pas de gouvernement central pour l’instant, démilitarisation, dénazification et maintien des zones d’occupation — cède rapidement la place à des désaccords majeurs.
Staline réclame de lourdes réparations, notamment pour compenser les destructions subies par l’URSS. Mais les Anglo-Américains, échaudés par les conséquences du Traité de Versailles en 1919, refusent d’affaiblir l’Allemagne au point d’en faire un terreau de revanche. Autre sujet de discorde : la Pologne. Staline entend imposer un gouvernement pro-soviétique, ce que les Occidentaux contestent sans parvenir à l’empêcher.
Le secret atomique et l’ombre d’un nouvel équilibre
Au moment de la conférence, Truman reçoit un message crucial : le 16 juillet, les États-Unis ont testé avec succès leur première bombe atomique dans le désert du Nouveau-Mexique. Ce développement bouleverse les équilibres stratégiques. Il informe Churchill le 18 juillet, mais ne donne à Staline qu’une version vague des faits. Ce dernier, bien que surpris, garde son calme et ne révèle pas que ses services de renseignement sont déjà informés de l’essai.
Ce nouvel atout donne à Truman un sentiment de supériorité qui influence sa position dans les discussions. Dans ses lettres privées, il se montre confiant, déclarant : « J’ai quelques atouts en main. »
Sphères d’influence et réalpolitique
La conférence consacre le principe des sphères d’influence, même si cela n’est jamais formellement dit. L’Europe de l’Est tombe sous la domination soviétique, tandis que la Grèce, l’Espagne et l’Italie restent dans le giron occidental. L'Allemagne est divisée, la frontière avec la Pologne est déplacée vers l’ouest sur la ligne Oder-Neisse, permettant à cette dernière de récupérer des territoires au détriment de l'Allemagne, en compensation de ceux annexés par l'URSS.
Churchill, affaibli par l’attente des résultats des élections britanniques, espère reprendre le dessus. Mais le 26 juillet, il est remplacé par le travailliste Clement Attlee, après une défaite électorale majeure. Ce dernier, peu charismatique et sans poids politique dans les tractations, laisse désormais le face-à-face se jouer entre Truman et Staline.
Une paix affichée, une guerre latente
La conférence s’achève le 2 août. Officiellement, les trois dirigeants s’engagent à construire « les conditions d’une paix durable en Europe ». Mais derrière les sourires de circonstance, les désaccords profonds et les arrangements tacites ont posé les bases d’une rivalité systémique entre deux visions du monde : capitaliste et démocratique à l’Ouest, communiste et autoritaire à l’Est.
Dans ses Mémoires, Truman décrira cette rencontre comme « une rude épreuve de force » et conclura : « Les Soviets ne comprennent qu’une seule chose : la force. » Cette conviction guidera toute la politique étrangère des États-Unis pendant les décennies suivantes.
Un tournant historique
La conférence de Potsdam marque un moment charnière : l’éclatement officiel du camp des vainqueurs. Alors que l’euphorie de la victoire contre le nazisme aurait pu ouvrir la voie à une paix véritablement concertée, les intérêts divergents, la méfiance mutuelle et les ambitions géopolitiques ont semé les graines de la guerre froide. Potsdam, plus qu’un épilogue à la Seconde Guerre mondiale, est en réalité le prologue d’un nouvel affrontement mondial, qui durera près d’un demi-siècle.
Prière de partager vos commentaires sur:
[email protected]
 Politique
Politique