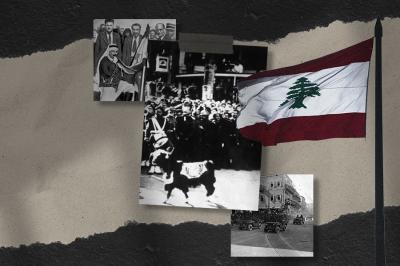À l'été 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle ère géopolitique s'ouvre. Le 26 juin, à San Francisco, cinquante nations signent la charte fondatrice de l’Organisation des Nations unies (ONU), marquant la fin de la Société des Nations (SDN) et la naissance d’un nouvel ordre mondial. Ce moment historique reflète la volonté des Alliés de pérenniser leur coopération militaire sous une forme politique et diplomatique.
L’initiative est portée par le président américain Franklin D. Roosevelt, qui rêvait d’un gouvernement mondial sous la direction des États-Unis. L’ONU devient ainsi l’un des piliers de ce nouvel ordre, aux côtés de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), deux institutions qui visent à stabiliser l’économie mondiale.
La conférence de San Francisco débute le 25 avril 1945, alors même que l’Allemagne nazie est sur le point de capituler. Elle réunit une diversité impressionnante de pays: toutes les Amériques, presque toute l’Europe (hors puissances vaincues comme l’Allemagne et l’Italie), les dominions britanniques, l’URSS avec deux de ses républiques fédérées (Ukraine et Biélorussie), les États indépendants d’Afrique et d’Asie, à l’exception notable du Japon encore en guerre. Au total, 3 500 participants, dont diplomates, journalistes et représentants d’organisations non gouvernementales, assistent à l’événement. Seuls les États-Unis ont l’infrastructure et la stabilité pour accueillir une telle conférence – d'où le choix de San Francisco.
Derrière l’apparat floral et l’atmosphère détendue décrite par des témoins comme l’écrivain E. B. White, la conférence cache des enjeux politiques majeurs. Le monde bascule dans une configuration dominée par la puissance économique et militaire américaine. En 1945, les États-Unis représentent à eux seuls 59 % du produit national brut (PNB) mondial, bien loin devant l’URSS et le Royaume-Uni, pourtant eux aussi vainqueurs. L’Europe continentale est exsangue : l’économie française a chuté de 46 %, celle de l’Allemagne de 40 %, et celle du Japon de 57 %.
L’idée de « Nations unies » émerge dès 1942, lorsque les Alliés formalisent leur union face à l’Axe. Ce terme désigne d’abord l’alliance militaire, mais très vite, les ambitions s’élargissent : il s’agit d’élaborer un cadre institutionnel mondial fondé sur la paix, la justice et les droits humains – à l’opposé de l’idéologie totalitaire nazie. Des textes fondateurs, comme la Charte de l’Atlantique (août 1941) ou la déclaration de Saint-James (juin 1941), avaient déjà posé les bases morales et politiques de cette vision. Ces principes sont progressivement précisés lors des sommets de Moscou, Téhéran, Yalta et Potsdam.
Les discussions concrètes pour structurer cette future organisation ont lieu à Dumbarton Oaks, à Washington, entre août et octobre 1944. Là, les diplomates américains, soviétiques et britanniques conçoivent la structure de l’ONU, prévoyant une Assemblée générale et un Conseil de sécurité dominé par cinq membres permanents (États-Unis, URSS, Royaume-Uni, Chine, et – après négociations – la France). Chaque membre permanent y détient un droit de veto, garantissant l’équilibre des forces. La France, d'abord écartée, parvient à se réintégrer dans le jeu diplomatique grâce à l'habileté de ses représentants, notamment Georges Bidault et René Cassin.
Roosevelt imagine une ONU placée sous l'influence des États-Unis, garante d’une paix mondiale régulée. Staline y voit un outil pour défendre les intérêts soviétiques et accroître son poids. Churchill, lui, cherche à maintenir le rang de l’Empire britannique dans le monde d’après-guerre. Chacun défend ses intérêts, mais tous veulent éviter une nouvelle guerre mondiale.
La conférence de San Francisco n’est pas une simple formalité : les négociations y sont vives. La structure de l’ONU est finalement acceptée, mais elle contient déjà les germes de la future guerre froide. Dès 1946, l’URSS se replie et bloque certaines initiatives, réduisant l’ONU à un rôle proche de celui de la SDN. Toutefois, les Occidentaux relancent l’ordre multilatéral par d’autres moyens : Banque mondiale, FMI, OCDE, GATT, puis l’OTAN. Ces institutions, nées de la même dynamique, vont assurer la reconstruction de l’Europe et l’hégémonie américaine pendant plusieurs décennies.
Quant à l’ONU, elle fixe son siège à New York, symbole éclatant de la suprématie américaine. Malgré ses limites, elle demeure l’un des cadres les plus durables du dialogue international.
Prière de partager vos commentaires sur:
[email protected]
 Politique
Politique