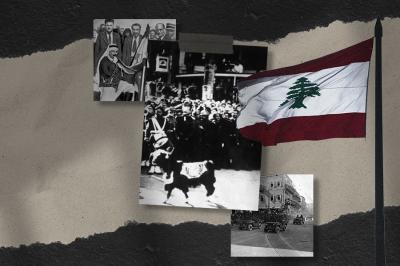Le 5 juillet 1945, une surprise électorale bouleverse le Royaume-Uni : Winston Churchill, héros de la Seconde Guerre mondiale, est massivement rejeté par les électeurs britanniques. Trois mois plus tôt, en mai, sa popularité culminait à 85 %. Pourtant, aux élections générales, les travaillistes remportent une victoire écrasante. Une situation qui interroge encore aujourd'hui : pourquoi les Britanniques ont-ils désavoué leur chef de guerre aussi brutalement ?
Le contexte est celui de l’après-guerre. Le 23 juillet 1945, lors de la conférence de Potsdam réunissant les grandes puissances victorieuses (États-Unis, URSS, Royaume-Uni), Churchill partage la scène avec Clement Attlee, chef du Parti travailliste et vice-Premier ministre du gouvernement d’union nationale. Le dépouillement des élections britanniques, tenues le 5 juillet, est retardé par l’intégration des votes de cinq millions de soldats dispersés dans le monde.
Les conservateurs s’attendaient à perdre quelques sièges, mais à rester au pouvoir. Or, les résultats annoncent un véritable séisme politique : les travaillistes remportent 49,7 % des voix et 393 sièges sur 640, contre 197 pour les conservateurs. Un gain de 239 sièges pour le Labour, une défaite historique pour Churchill. Certains témoins disent qu’il a pleuré. Dans ses mémoires, il résume son désarroi par une phrase poignante : « Ainsi donc, la faculté de façonner l’avenir m’était retirée. »
Comment expliquer cette rupture entre Churchill et le peuple britannique ? Les analystes de l’époque font une distinction entre le chef de guerre, respecté à l’unanimité, et le politicien, bien plus controversé. Les travaillistes ont mené une campagne moderne, dynamique, alors que les conservateurs se sont appuyés sur la figure de Churchill et n’ont pas su proposer une vision claire de l’après-guerre.
Churchill lui-même admet les limites de la campagne conservatrice. Il souligne que de nombreux cadres tories étaient encore mobilisés à l’étranger, tandis que les cadres travaillistes, issus du monde syndical, étaient restés au pays, participant à l’organisation de l’économie de guerre. Cela leur a donné un avantage logistique et stratégique.
Mais la cause principale de la victoire travailliste pourrait résider dans le paradoxe de la politique de guerre menée par Churchill. Pour faire face à la menace nazie, le Royaume-Uni a dû adopter des mesures de type collectiviste, en contradiction avec sa tradition libérale : conscription, contrôle des prix et des salaires, rationnement, mobilisation totale de la population. Ces mesures ont profondément transformé la société britannique. Dix pour cent de la population a été enrôlée, sans distinction de classe. Les femmes ont été intégrées à l’effort de guerre, y compris dans des rôles techniques et militaires.
L’économie a été placée sous la tutelle d’un ministère de la Production. Des lois d’exception ont permis la détention sans procès, la censure, la réquisition des biens, l’encadrement de la main-d’œuvre. Pour beaucoup de Britanniques, ces politiques ont montré l’efficacité d’un État fort et organisé.
Alors que les conservateurs souhaitent un retour au mode de vie traditionnel d’avant-guerre, les travaillistes y voient l’opportunité de bâtir une société plus juste. Leur programme électoral de 1945, intitulé Let Us Face the Future (« Tournons-nous vers l’avenir »), promet de prolonger les réformes de guerre en les adaptant à la paix : logement, éducation, santé, loisirs. Le manifeste affirme que la victoire est celle du peuple, pas d’un homme seul. Il met en garde contre le retour au pouvoir des élites conservatrices, synonymes de chaos social.
Ce programme séduit massivement un électorat lassé des privations mais conscient de l’efficacité de la gestion collective. L’expérience de la guerre a transformé les mentalités, et les promesses travaillistes résonnent profondément dans une population en quête de progrès social. Le Labour applique presque entièrement ce programme pendant six ans.
Cette transition marque un tournant dans l’histoire du Royaume-Uni. Même le retour de Churchill au pouvoir en 1951 ne renversera pas entièrement les acquis de cette période. Ce n’est qu’avec l’arrivée de Margaret Thatcher en 1979 que le pays amorcera un retour à l’économie libérale.
Des voix discordantes, comme celle de Friedrich Hayek dans La Route de la servitude (1944), mettent pourtant en garde contre les dangers d’une économie dirigée, susceptible de conduire à la dictature. George Orwell, dans son roman 1984, prolonge cette réflexion en décrivant un régime totalitaire fondé non sur le stalinisme ou le fascisme, mais sur une forme dévoyée de socialisme britannique, l’Ingsoc.
En définitive, la défaite de Churchill n’est pas un rejet de sa personne mais de ce qu’il représente politiquement. Le peuple britannique, fort de son expérience de guerre, choisit le changement social profond plutôt que la continuité politique. L’homme qui a mené le pays à la victoire se voit ainsi écarté au moment de la paix, dans une des plus grandes ironies de l’histoire politique moderne.
Prière de partager vos commentaires sur:
[email protected]
 Politique
Politique