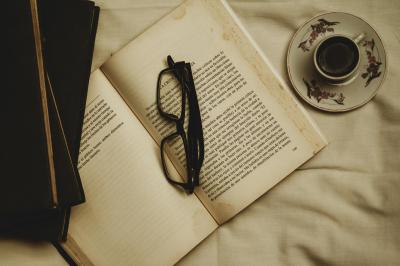Dans une scène qui redessine la carte de la sécurité au Sud et dans la Békaa, le Liban assiste à une reprise à grande échelle des opérations de déminage et d’enlèvement des munitions non explosées. C’est une étape où les efforts internationaux et locaux convergent pour redonner vie à des terres privées de sécurité depuis des décennies. La question n’est plus seulement de supprimer un danger militaire ancien, mais de mener un projet humanitaire et de développement qui touche quotidiennement la vie de milliers de familles.
Le rôle des Nations unies et des organisations internationales
La semaine dernière, la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) a repris les opérations de déminage humanitaire dans le Sud, à la demande officielle du gouvernement libanais, après près de deux ans de suspension en raison des tensions sécuritaires le long de la Ligne bleue.
Des équipes spécialisées venues du Cambodge et de Chine travaillent désormais dans les zones de Blida et de Maroun al-Ras, sur une superficie estimée à 18 000 m². Leur mission s’inscrit dans le cadre d’un protocole d’accord signé avec l’armée libanaise en mars dernier, visant à renforcer la coopération et à affermir l’autorité de l’État sur la frontière. La FINUL a également porté ses équipes de déminage à 24, contre seulement 9 à l’automne 2023, permettant ainsi d’élargir les opérations aux routes et aux munitions non explosées.
Parallèlement, l’organisation Mines Advisory Group (MAG) a achevé un projet majeur financé par le ministère allemand des Affaires étrangères, d’une valeur de 2,2 millions d’euros et courant jusqu’en février 2025. L’initiative a enregistré des résultats notables, notamment :
- Le déminage de 286 846 m² de terrains contaminés (l’équivalent de 40 terrains de football).
- La restitution de 10 zones sûres à usage agricole et résidentiel.
- Le soutien de 13 villages quotidiennement exposés aux risques des sous-munitions.
- L’organisation de plus de 230 sessions de sensibilisation pour environ 3 000 personnes, principalement des enfants, ainsi que des campagnes numériques ayant touché 4,44 millions de Libanais.
- La protection directe de 9 000 personnes grâce aux opérations de déminage et de sensibilisation.
Ces efforts ont eu un impact immédiat sur la vie des habitants. « Après le déminage de la zone, mes moutons ont pu revenir paître en toute sécurité. J’ai retrouvé ma source de revenu quotidien après des années de peur », témoigne Salim Hazra, de la Békaa occidentale.
Une dimension humanitaire et sécuritaire
Ces efforts surviennent à un moment sensible marqué par la montée des tensions dans le Sud. Aujourd’hui, le déminage ne signifie pas seulement l’élimination des vestiges des guerres passées, mais constitue aussi un investissement à long terme dans :
- Le renforcement de la sécurité alimentaire en rendant les terres à l’agriculture.
- Le soutien aux infrastructures, aux projets de logement et d’éducation.
- La réduction des déplacements internes et le renforcement de la stabilité sociale.
La terre, source de vie
Le spécialiste en sécurité humaine, le Dr Fadi Mourad, souligne : « Le déminage est aussi vital que la reconstruction des hôpitaux et des écoles. La terre est la source de vie des Libanais, et l’agriculture est une soupape de sécurité sociale et économique. Ce qui se fait aujourd’hui n’est pas une simple opération technique, mais un projet stratégique pour redonner confiance aux habitants dans leur capacité à rester dans leurs villages, au lieu de songer à l’émigration ou au déplacement. »
Vers une nouvelle étape
Ces opérations révèlent un tournant qualitatif dans l’approche du Liban vis-à-vis du dossier des mines, fondé sur un partenariat tripartite entre l’armée libanaise, les institutions internationales et les organisations humanitaires. L’objectif ne se limite plus au nettoyage des terres, mais à la construction de capacités locales durables garantissant la sécurité des générations futures.
À mesure que ces projets s’achèvent, des zones longtemps interdites et dangereuses se transforment en espaces sûrs pour l’agriculture, l’éducation et le logement—ouvrant ainsi la voie à l’investissement et au développement dans les régions frontalières et montagneuses, longtemps marginalisées et exposées aux risques.
Prière de partager vos commentaires sur:
[email protected]
 Politique
Politique