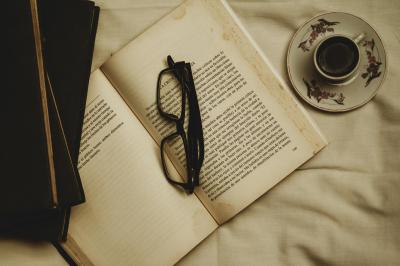À la suite de la guerre entre le Liban et Israël déclenchée après les événements du 7 octobre 2023, la banlieue sud de Beyrouth, ainsi que le sud du pays et la plaine de la Békaa, ont subi des dégâts dévastateurs aux niveaux civil, urbain, économique et social. Cette banlieue — considérée comme le cœur de la vie sociale et économique de la communauté chiite au sud de la capitale — porte aujourd’hui les stigmates d’un conflit qui a frappé les habitations, les infrastructures, les secteurs vitaux et les habitants eux-mêmes.
Des pertes catastrophiques : des chiffres fiables issus de multiples sources
- La Banque mondiale a estimé les pertes économiques globales du Liban à 5,1 milliards de dollars, auxquelles s’ajoutent 3,4 milliards de dollars de dégâts aux infrastructures, pour un total de 8,5 milliards de dollars.
- Le secteur du logement à lui seul a subi des dommages estimés à 2,8 milliards de dollars, avec environ 99 209 unités d’habitation endommagées ou détruites.
- Le secteur agricole a perdu plus de 700 millions de dollars, selon un rapport conjoint de l’ONU et du ministère libanais de l’Agriculture. Cela inclut 118 millions de dollars de dégâts directs et 586 millions de pertes de production, avec des besoins de reconstruction évalués à 263 millions de dollars.
- Les pertes du commerce, dues aux arrêts et perturbations, se sont élevées à 1,7 milliard de dollars.
- Le secteur du tourisme et de l’hôtellerie a perdu près de 1,1 milliard de dollars.
Les pertes dans l’éducation ont été évaluées à 215 millions de dollars, dans l’environnement à 221 millions, et dans la santé entre 74 millions de dollars de dégâts et 338 millions de pertes.
Concentration des dégâts dans la banlieue sud
Les zones les plus touchées incluent Nabatieh, Saïda, Tyr, Bint Jbeil et Marjayoun, jusqu’à la banlieue sud de Beyrouth, qui à elle seule a enregistré environ 144 millions de dollars de dommages — un chiffre qui ne reflète qu’une partie de la destruction totale.
Des analyses satellitaires ont révélé que de 25 à 50 % des bâtiments dans des villages du sud, comme Aïta al-Chaab et Kfar Kila, ont été endommagés, illustrant l’ampleur massive du désastre matériel.
Un rapport local a estimé qu’en seulement six mois, les dégâts directs dans le sud du Liban ont atteint 370 millions de dollars, tandis que les pertes indirectes — dues principalement au ralentissement économique et touristique — ont totalisé 1,1 milliard, portant le coût global à 1,5 milliard de dollars. D’autres évaluations fixent les pertes globales dans le sud à 1,2 milliard de dollars, dont 280 millions de dégâts directs dans les infrastructures et l’agriculture, et 300 millions de pertes indirectes.
Compensation et réparations : efforts de l’État et soutien international
Le ministre des Finances, Yassine Jaber, a annoncé une première allocation de 200 milliards de livres libanaises à la Haute Commission de secours, provenant du Trésor public, pour entamer les réparations urgentes. Il a également révélé un prêt de 250 millions de dollars de la Banque mondiale, destiné à la reconstruction des infrastructures endommagées par l’agression israélienne — une étape essentielle vers la stabilisation de cette région stratégique.
En parallèle, le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi dans le budget 2025 prévoyant une allocation mensuelle de 12 millions de livres aux retraités de la fonction publique civile. Cette mesure s’inscrit dans un effort plus large de correction des salaires face à la dégradation des conditions de vie et aux fragilités financières de l’État. La décision est perçue comme un signal que le gouvernement entend lancer la reconstruction malgré ses moyens limités, tout en accueillant favorablement le soutien de pays amis et d’institutions internationales, notamment la Banque mondiale.
Quelle solution ?
Dans un entretien accordé à Al Safa News, l’économiste et expert social Dr Fouad Moussallem a souligné que la reconstruction ne pouvait se limiter aux compensations financières et aux prêts. Elle exige un plan stratégique de long terme, comprenant :
- La reconstruction des infrastructures vitales (électricité, eau, routes, écoles et hôpitaux) de manière moderne et durable.
- L’indemnisation des résidents touchés et des petites et moyennes entreprises afin de relancer progressivement l’activité économique.
- Le lancement de projets de développement productifs créant des emplois et renforçant la résilience des populations face aux crises futures.
- Le renforcement de la transparence et de la gouvernance dans la gestion des fonds de reconstruction, qu’ils proviennent du Trésor public ou de l’aide extérieure, pour éviter le gaspillage et garantir leur arrivée aux bénéficiaires.
- L’implication des communautés locales dans la définition des priorités de reconstruction, afin de renforcer la confiance entre citoyens et État.
Moussallem a conclu que le plus grand défi réside dans la capacité de l’État à concilier reconstruction rapide et stabilité financière et sociale — ce qui requiert une coopération étroite entre gouvernement, secteur privé et bailleurs internationaux.
Vers une reconstruction équitable et durable
Les leçons sont claires : le Liban a subi sa pire dévastation depuis 2006, et la banlieue sud de Beyrouth reste une plaie ouverte reflétant la souffrance de l’État et de ses citoyens. Les chiffres — issus de la Banque mondiale et de sources locales — font état d’une catastrophe de 8 à 9 milliards de dollars de pertes, avec des milliers de logements réduits en ruines et des centaines de milliers de personnes déplacées ou privées de leurs moyens de subsistance.
Les priorités aujourd’hui sont :
- Assurer un financement durable via le budget national et l’aide internationale.
- Donner la priorité à la transparence et à la gouvernance pour garantir une distribution équitable des fonds.
- Impliquer activement les communautés locales dans la fixation des priorités.
- Combiner compensation directe, reconstruction des infrastructures et projets de développement pour restaurer espoir et perspectives.
Ce n’est qu’à travers cette vision globale que la catastrophe actuelle pourra être transformée en une opportunité de rebâtir la banlieue sud de Beyrouth sur des bases de dignité, d’équilibre social et de relèvement national.
Prière de partager vos commentaires sur:
[email protected]
 Politique
Politique